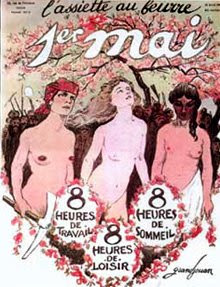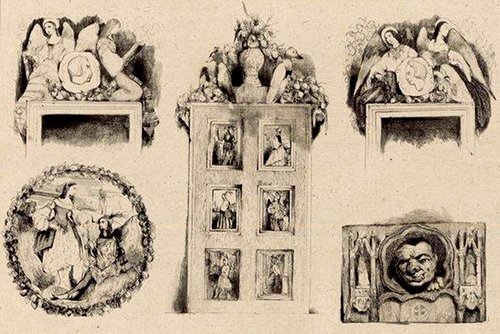L'occasion de ce parcours est une emmenée promener autour de la librairie
Publico, 145 rue Amelot dans le 11ème.
 |
| 1925. Meurisse. Gallica |
- Théâtre du Château d’Eau (plus
tard Alhambra), 50 rue de Malte.
Y est donné, en mars 1871, un vaudeville, Le Procès des francs-fileurs,
d’après le qualificatif inventé par le Tintamarre
pour ceux qui, lors du siège de Paris, avaient prudemment fui en province ou à
l’étranger.
- Alhambra (puis "Alhambra Maurice
Chevalier"), 50 rue de Malte
(démoli en 1967; l'actuel parking souterrain y porte encore ce nom d'Alhambra).
En 1936, Gilles et Julien y chantent
« La Belle France :
il était question de bleuets et de coquelicots, on aurait dit du
Déroulède » ironise Simone de Beauvoir, mais ils ont aussi à leur
répertoire La chanson des 40 heures.
Des bâtiments contemporains de Marie Dorval au soir d'Antony, le 3 mai
1831 :
- 21, rue Meslay, PLU: maison de
la première moitié du XIXe siècle,
dernier étage en retrait desservi par un balcon filant. Balcon central de deux travées
au second étage soutenu par de puissantes consoles. Persiennes.
- 22, rue Meslay, (en face du 21)
PLU: accès cocher d'une grande cour pavée très régulière (formant un rectangle)
de l'immeuble de rapport de style néo-classique, fin 18ème, du 15 bd St-Martin.
- Au n°19, maison du début du
XIXe siècle. La façade est encadrée de
deux chaînes. Le décor du rez-dechaussée simule un faux appareil. Porte
cochère.
- 18, rue Meslay, PLU: 1ère
moitié du 19ème, arrière du 11 boulevard Saint-Martin, donnant sur la large
cour pavée comportant deux anciennes fontaines en fonte.
- n°17, PLU: remarquable grande
maison Louis-Philippe présentant un riche décor de moulures inspiré de la
Renaissance française et un grand balcon en pierre sculpté desservant les trois
travées centrales de l'étage noble. Oeuvre non attestée de Ballu (construit sur
un terrain propriété de Ballu père).
- Appartement de Marie Dorval, 15 rue Meslay. Là qu’on raccompagne
l'actrice le soir d’Antony. Voir la balade Hugo en
anarcho-autonome dans le ravin du bd Saint-Martin.
(Elle quittera l'adresse pour le 44, rue
Saint-Lazare, en 1833, avec Alfred de
Vigny, sa nouvelle liaison. Puis, en octobre 1835, Marie Dorval, la Kitty
Bell de Chatterton, drame en
prose que Vigny a écrit pour elle, emménagera au 1er étage du 40, rue Blanche, parce qu’il y là pavillon
d’écurie et remise où la voiture et les chevaux qu’elle possède désormais
pourront trouver place).
George Sand la connaît après Indiana,
en 1832 ; elle lui écrit, Marie Dorval accourt (elle a 34 ans, Sand six de
moins), long portrait dans Histoire de ma vie : « Elle
était mieux que jolie, elle était charmante ; et cependant elle était jolie,
mais si charmante que cela était inutile. Ce n'était pas une figure, c'était
une physionomie, une âme. »C'était
une époque où « se manifestait un paroxysme de passion peu voilé », où
l'on aimait les poitrinaires parce que leur amour était plus brûlant, où l'on
ouvrait les tombes pour revoir l’aimé. On connaît des lettres enflammées de
Sand, de Vigny à Marie Dorval, datées de 1833-34, et de l'une, de Vigny, Léon
Séché écrira qu'elle est « l’acte d’un malade et d’un fou » : « Il
fallait vraiment que Vigny eut perdu la raison pour avoir écrit la lettre qui
commence par « Pour lire au lit » ». Cette lettre a été détruite
en 1913.
D'autres maisons contemporaines de ce temps de feu :
- 14, rue Meslay (en face du 9),
arrière du 3 boulevard Saint-Martin, PLU: Immeuble de rapport de la fin du
XVIIIe siècle.
- 11, rue Meslay, PLU: Grande
maison à loyer vers 1800 présentant une façade néo-classique très bien
conservée. La façade est bornée par deux chaînes d'angle. Le rez-de-chaussée
est orné de refends. Trait de refends dans l'enduit sur le reste de la façade.
Garde-corps à motif de losanges. Persiennes ajoutées ultérieurement.
Hiérarchisation de la taille des baies en fonction des étages. Porte cochère surmontée d'un fronton triangulaire
inspirée par Ledoux et ouvrant sur une cour pavée. Escalier à barreaux ronds
sur limon conservé.
- Fédération de la Seine du
Parti Socialiste S.F.I.O., 7 bis
rue Meslay. C’est du même coup l’adresse de la Librairie fédérale, et aussi le siège d’une coopérative de
production et de distribution de films, l’Equipe,
créée vers février 1937.
Le 16 mars 1937, une militante du
18e arrondissement de la Gauche
révolutionnaire, la tendance de Marceau
Pivert, sera parmi les six victimes de la police de Marx Dormoy, à Clichy.
« Les forces de police tirant sur les ouvriers antifascistes, et sous un
gouvernement du Front populaire à direction socialiste, est-ce la rançon de la
politique de confiance exigée par les banques ? » demande sur les
murs de Paris une affiche de la Gauche révolutionnaire, qu’en réponse la police
va lacérer, tandis que le PS aura interdit la tendance dès la fin d’avril.
Désormais sans nom, les amis de Pivert n’en auront pas moins conquis la
direction de la Fédération de la Seine neuf mois plus tard. C’est alors sa
Fédération de la Seine toute entière que la direction du PS dissout, le 11
avril 1938. Les dissous s’entêtent et se maintiennent de force dans les locaux
de la rue Meslay : « Ils veulent la dissolution pour mieux trahir,
nous répondons, la Fédération continue », affirme Juin 36, leur hebdomadaire. Mais ils s’inclineront devant le
congrès qui, en juin, confirme la dissolution. Marceau Pivert y annonce alors
la création du Parti Socialiste Ouvrier
et Paysan (PSOP).
Dans cette même rue, les
Gerhardt, réfugiés antinazis, ouvrent en 1933 une librairie qui sera un lieu de
rencontre d’immigrés politiques allemands.
- les Editions Sociales, 168, rue du Temple, dans les années
1970 encore. S’y trouve aussi La Pensée, revue du rationalisme moderne.
On descend la rue Turbigo pour
passer devant la rue du Vertbois:
- table d’hôte de la mère
Caviole, rue du Vertbois.
C’est la cantine du noyau de laRévolution prolétarienne,
alors rue du Château d’eau : Monatte,
Robert Louzon quand il passe à
Paris, le Dr Louis Bercher, médecin de la marine marchande qui signe J. Péra, Daniel Guérin.
Puis par le passage
Ste-Elisabeth, le long d'une église que l'on doit au maître-maçon Michel
Villedo, dédiée à sainte Élisabeth de Hongrie et à Notre-Dame de Pitié,
consacrée en 1646 par Jean-François Paul de Gondi, futur cardinal de Retz, alors
coadjuteur de l'archevêque de Paris (MH), on rejoint la :
 |
| Rue Dupetit-Thouars. Atget. Gallica |
- salle du 10 rue Dupetit-Thouars. (Et 22, rue de la
Corderie), PLU: Maison d'angle vers le milieu du XIXe présentant une façade bien proportionnée
composée de sept travées sur la rue Dupetit Thouars et de deux travées
principales sur la rue de la Corderie et de trois étages carrés sur
rez-de-chaussée. Des bandeaux séparent les étages. Persiennes en bois.
C'est dans cette salle que juste
après l’armistice de 1918, la Muse Rouge
vient se produire. (Voir pour ce groupe la balade Hugo en
anarcho-autonome dans le ravin du bd Saint-Martin). La Muse
Rouge y sera de retour une douzaine d’années plus tard, quand déclarée par le
PC « en dehors du mouvement culturel de lutte de classe », elle aura
été chassée de la Maison Commune, devenue communiste, du 3e
arrondissement.
La Muse Rouge aura son siège
entretemps à l’Union des coopératives,
(voir plus bas).
- 16, rue de la Corderie, siège du Parti Socialiste (SFIO) en
1910. PLU : Maison ancienne présentant une façade composée de quatre travées
principales et d'un étage carré sur rez-de-chaussée. Persiennes. Lucarnes en
"chiens assis". Passage cocher ouvrant sur une cour.
 |
| Le 2, rue de la Corderie. Atget. Gallica |
- L’Assommoir, 6 place de la Corderie-du-Temple (auj.
14, rue de la Corderie), au
rez-de-chaussée. Le cabaret était connu dans tout l’arrondissement sous
ce nom, même s’il n’en portait aucun ; il inspirera Zola, dont le roman éponyme, publié en feuilleton en 1876 dans le Bien public, propriété d’Emile Menier, le célèbre chocolatier,
sera immédiatement accusé « d’insulter la classe ouvrière », et sa
publication interrompue pour ne se poursuivre qu’avec des coupures, un mois
plus tard, dans la République des
lettres dirigée par Théodore de
Banville.
- Bal Montier, 6 place de la Corderie-du-Temple, au 1erétage. S’y réunissaient jusque vers 1858, trois sociétés chantantes, les
mardi, jeudi et samedi, au public exclusivement composé d’ouvriers. Dans celle
dite Les Enfants du Temple, le
jeudi, sous la présidence de Dalès aîné, se retrouvaient les chansonniers
Auguste Alais, horloger, Eugène Baillet, ouvrier bijoutier, Charles Colmance, graveur sur bois pour
impression sur étoffes, qui y chanta l’anticolonialiste Chant de l’Arabe vers 1850, Charles Gilles, coupeur de corsets, Gustave Leroy, brossier, Victor
Rabineau, sculpteur marbrier.
- Chambre Fédérale des
sociétés ouvrières, 6 place de la
Corderie-du-Temple. Formée entre mars et décembre 1869, elle réunit les
principales sociétés ouvrières de la capitale ; tous ses animateurs, dont Varlin, sont des Internationaux. Elle
siège à la « Corderie ».
Il a fallu une décennie, après la
répression des années 1850, pour que des grèves éclatent à Paris, les plus
retentissantes étant, de 1862 à 1864, celles des typographes. Elles ont été
sanctionnées de peines sévères mais l’empereur a ensuite accordé sa grâce, et
demandé au Corps Législatif de voter une loi abolissant le délit de coalition
(de grève), ce qui sera fait au printemps 1864. Les bronziers se mettent en
grève dès l’année suivante sur la durée du travail. Si le droit de coalition a
été acquis, le droit d’association (de se syndiquer) n’existe toujours pas, et
les délégations ouvrières à l’Exposition de 1867 revendiqueront le droit de
constituer des chambres syndicales. L’Empire, sur sa fin, laisse à peu près
faire, tandis qu’il impulse une Caisse des Invalides du Travail - où siège le
coupeur de chaussures Jacques Durand, futur membre de la Commune -, et que
préfectures et municipalités développent des Sociétés de Secours Mutuels qui
vont intégrer 15 à 20% de l’effectif ouvrier. De nombreuses grèves visent à
obtenir un droit de contrôle, voire de gestion, des caisses de secours
qu’alimentent les amendes dont les ouvriers sont frappés. La Chambre des
cordonniers, sans doute la première en ce domaine, a dès 1866 des statuts
prévoyant, en leur article 2, que les ouvrières seront consultées, et qu’elles
exerceront le même ordre de contrôle que les hommes. La tolérance est quasi
officialisée en août 1868, et les grèves de 1868-1869 vont multiplier les
chambres corporatives.
Une Fédération des sections
parisiennes regroupe, le 3 mars 1870, des sections qui se sont constituées par
quartier à côté de la fédération de métiers. Le 4 septembre 1870, les délégués des chambres syndicales
ouvrières, les membres de l’Internationale et les socialistes les plus connus
comme orateurs des réunions publiques se réunissent place de la Corderie. Ils adoptent une adresse au peuple allemand,
à la fois aux autorités pour les prendre au mot de leurs déclarations de non
ingérence, et aux ouvriers allemands pour les conjurer de cesser de prendre
part à cette lutte fratricide. Mais comment la diffuser largement à l’armée
allemande ? La réunion nomme aussi une délégation pour aller à l’Hôtel de
Ville assurer la Défense nationale de son concours, sous réserve d’un certains
nombre de conditions, dont la deuxième est « la suppression de la
préfecture de police et la restitution aux municipalités parisiennes de la
plupart des services centralisés à cette préfecture ». La délégation sera
reçue à 1 heure du matin par Gambetta
pour l’entendre multiplier des promesses vagues.
Dans l’intervalle, l’assemblée a
également décidé de susciter 20 comités d’arrondissement, ou comités
républicains de vigilance, élus dans les réunions populaires de leur
arrondissement et qui, par l’envoi de quatre délégués chacun, constitueraient
un Comité Central. Celui-ci sera sur pieds dès le 11 septembre et s'installera à la Corderie. Trois jours plus tard,
il fait placarder un avis, - « Le
Comité central républicain des 20 arrondissements aux Citoyens de
Paris », signé Cluseret, Napoléon Gaillard, Charles Longuet, Benoît Malon,
Edouard Vaillant, Jules Vallès, entre autres -, qui reprend les conditions
portées par la délégation, dont le premier est maintenant « Supprimer la
police telle qu’elle était constituée sous tous les gouvernements monarchiques
pour asservir les citoyens et non pour les défendre ».
- section parisienne
de l’Internationale, 6 place de la Corderie-du-Temple, 3e étage. Elle
s’installe ici après la rue des Gravilliers : « Connaissez-vous,
entre le Temple et le Château-d’Eau, pas loin de l’Hôtel de Ville, une place
encaissée, tout humide, entre quelques rangées de maisons ? Elles sont
habitées, au rez-de- chaussée, par de petits commerçants, dont les enfants
jouent sur les trottoirs. Il ne passe pas de voitures. Les mansardes sont
pleines de pauvres !
On appelle ce triangle vide la Place de la Corderie.
C’est désert et triste, comme la rue de Versailles où le
tiers état trottait sous la pluie ; mais de cette place, comme jadis de la rue
qu’enfila Mirabeau, peut partir le signal, s’élancer le mot d’ordre que vont
écouter les foules.
Regardez bien cette maison qui tourne le dos à la Caserne et
jette un œil sur le Marché. Elle est calme entre toutes. –
Montez !
Au troisième étage, une porte qu’un coup d’épaule ferait
sauter, et par laquelle on entre dans une salle grande et nue comme une classe
de collège.
Saluez ! Voici le nouveau parlement !
C’est la Révolution qui est assise sur ces bancs, debout
contre ces murs, accoudée à cette tribune : la Révolution en habit d’ouvrier !
C’est ici que l’Association internationale des travailleurs tient ses séances,
et que la Fédération des corporations ouvrières donne ses rendez-vous. » Ainsi
la décrivait Jules Vallès, dans le Cri du Peuple du 27 février
1871, repris dans L’Insurgé.
Le 21 mars 1871, le Comité central républicain, réuni à la
Corderie, entend Camelinat, Malon, et Vaillant faire le point de la situation, qui conduit, deux jours
plus tard à un appel, « Aux urnes, citoyens ! », signé aussi par
Eugène Pottier et Vallès.
Le cortège funèbre de Paul et Laura Lafargue, née Marx, à la fin de novembre 1911,
derrière des corbillards chargés d’immortelles rouges, est parti de la
Corderie. Par la rue des Fontaines, et la rue du Temple, il monte vers le père
Lachaise. Jean Longuet, leur neveu,
le fils de Jenny Marx (deux des
filles de Karl ayant épousé des internationalistes parisiens: « Le dernier
proudhonien et le dernier bakouniniste, que le diable les
emporte ! », bougonnait le papa), marche en tête de 15 000
personnes ; Alexandra Kollontaï
y représente le bureau étranger du parti socialiste russe, Lénine le Parti Ouvrier Social-Démocrate de Russie. Lui qui ne
parle jamais français en public fera pour ces funérailles sa seule exception.
 |
| Les 3 et 5 rue Béranger vus de la rue Charlot. 1898. Atget. Gallica. Remarquez sur le mur pignon la trace des fenêtres qui avaient donné sur la basse-cour de l'hôtel Bergeret de Frouville |
- 3 rue
Béranger, restes de l'Hôtel Bergeret de Frouville, 1720, qui semble aujourd'hui
ne former qu'un seul ensemble architectural avec l'immeuble voisin dit hôtel de
la Haye, du fait de leur acquisition à la fin du 19e siècle par la Ville de
Paris. La symétrie dans la composition des deux hôtels semble avoir été voulue
dès l'origine. Au 18e siècle, une basse-cour entourée de bâtiments s'étendait
au sud, à l'emplacement de l'actuelle rue de la Franche-Comté. On voit
aujourd'hui à cet endroit un vaste mur pignon où l'on devine encore les anciens
percements de la façade sur la basse cour de l'hôtel. A noter, à l'intérieur,
le bel escalier à rampe en fer forgé inscrit à l'Inventaire supplémentaire des
Monuments historiques en 1925 ainsi que de fort belles caves voûtées assez
semblables à celles de l'hôtel de la Haye au 5 rue Béranger.
- 5, rue Béranger, donnant sur 2 rue de la Corderie. Hôtel
de 1720. Son état actuel est fort semblable à la description qui en est faite
en 1776. L'entrée de l'hôtel se fait par une très belle porte monumentale,
inscrite sur l'Inventaire supplémentaire des Monuments historiques en 1926. A
l'intérieur de l'hôtel subsistent un très bel escalier déjà inscrit en 1926,
ainsi que de très belles caves voûtées transformées en réfectoire. Du très beau
décor intérieur, il subsiste un ensemble de boiseries fin 18e siècle, dans une
pièce du premier étage dans l'aile de droite. Ce serait dans cette pièce que Béranger serait mort, après y avoir
vécu 3 ans, le 16 juillet 1857. Il était né rue Montorgueil, « Dans
ce Paris plein d’or et de misère, / En l’an du Christ mil sept cent
quatre-vingt, / Chez un tailleur, mon pauvre et vieux grand-père ». Il
avait été admis, en 1813, comme membre du Caveau
Moderne, ou Rocher de Cancale,
qui se réunissait chez le marchand d’huîtres de la rue ; il avait été,
sous la Restauration, « un poète libéral, le seul vrai », dirait
Sainte-Beuve. Béranger avait sous-titré sa Conspiration
des chansons d’un Instructions
ajoutées à la circulaire de M. le Préfet de Police concernant les réunions
chantantes appelées goguettes. Au moment où il meurt, d’autres
chansonniers, dont Louis-Charles Colmance, se réunissent dans une goguette de
la rue, dite Les Épicuriens. Et au
n° 10 habite Frédérick Lemaître.
On remarque également dans certaines pièces des vestiges de
corniches à rinceaux et rubans, ainsi qu'à l'entrée de la cave un très beau
bas-relief représentant un jeune Bacchus (inscrit à l'Inventaire
supplémentaire des Monuments historiques en 1926).
 |
| 1901. Atget. Gallica |
- fontaine Boucherat : MH : Édifiée en 1697 par l’architecte parisien
Jean Beausire, elle porte le nom du chancelier Louis Boucherat.
- Union des coopératives, immeuble situé 29-31 bd du Temple et 85 rue
Charlot (auj. annexe de la Bourse du Travail).Acquise au début
de 1919, grâce au concours financier du Magasin
de Gros, de la Verrerie ouvrière
d’Albi et de la Bellevilloise,
cette Maison de la Coopération
remplace le siège installé auparavant au 13, rue de l’Entrepôt, dans le 10e.
Suivant les résolutions du congrès coopératif de 1912, qui préconisaient la
fusion, l’opération s’est faite avec La
Prolétarienne du 5e, l’Avenir
social du 2e, et la
Bercy-Picpus, tandis qu’est en cours un rapprochement avec l’Economie parisienne du 3e, La Lutèce sociale, et l’Union des coopérateurs parisiens.
L’Union des Coopératives compte maintenant 39 168 sociétaires,emploie
1 398 personnes et possède 230 établissements à Paris, en banlieue et dans
l’Oise, y compris trois colonies de vacances et trois entrepôts. Rien qu’au
cours de l’année écoulée, ont été ouverts à Paris, quatre restaurants, sept
épiceries et trois boucheries. Une blanchisserie est désormais commune à l’Union
des coopératives, à la Bellevilloise, à l’Union des coopérateurs parisiens et
aux restaurants ouvriers de Puteaux.
L’assemblée générale de 1919 vote
une subvention de 500 F en faveur de la Fédération
sportive du Travail (FST), et la création d’un challenge de 3 000
F ; et une autre subvention à l’Ecole
coopérative. Elle entérine la création en faveur des sociétaires, de cartes
de réduction pour le Théâtre Antoine et pour le Cirque d’hiver. Elle se
préoccupe de l’organisation d’une bibliothèque centrale à la Maison de la
Coopération, que doublerait une bibliothèque circulante. Un restaurant et une
brasserie y sont déjà installés, là où étaient Bonvalet et le café Turc son
voisin. Elle vérifie le fonctionnement du bulletin de l’Union des coopératives,
tiré à 28 000 exemplaires. Clamamus,
député-maire de Bobigny, est membre de sa Commission de surveillance.
La Muse Rouge y a son siège dans
les années 1920, après qu’elle a quitté la salle Jules. La société chantante
organise toujours des fêtes pour les organisations d’avant-garde ; elle
édite aussi, sous un titre éponyme, une « revue de propagande
révolutionnaire par les arts ». Le 21 février 1931, son assemblée générale
se prononce, à la majorité des membres, contre l’adhésion à la FTOF qui lui a été proposée. La
sanction ne se fait pas attendre : un mois plus tard, l’Humanité demande à toutes les organisations que le parti
influence de ne plus faire appel au groupe qui, par son refus, s’est placé
« en dehors du mouvement culturel de lutte de classe ».
 |
| 1928. agence Meurisse. Gallica |
Le donjon du Temple a été abattu
dans le même temps et quatre hangars construits devant la rotonde, faisant de
l’ensemble un colossal marché aux puces : on les désignait des sobriquets
pittoresques de Palais-Royal pour la
mode, Pavillon de Flore pour le
meuble, Pou-Volant pour la
ferraille, et Forêt-Noire pour la
chaussure. On n’y parlait à peu près que l’argot, et « être à court
d’argent » s’y disait, au choix, « nib de braise » ou
« nisco braisicoto ». En 1863, des halles type Baltard les
remplacent, qui ne conservent qu'un vestige 8, rue Perrée.
 |
| 1898. Atget. Gallica |
- Le marché des Enfants-Rouges,
Petit Marché du Marais en 1628, tira son nom ensuite de la proximité de
l'Hospice des Enfants-Rouges créé par Marguerite de Navarre pour des orphelins
dont l'uniforme était rouge. Il a été rénové à la fin des années 1990. MH.
- siège de la Fédération de
Paris du parti socialiste, 49 rue
de Bretagne. Au premier étage, une salle toute en longueur dotée d’une
petite scène. Lénine y avait donné, le 21 mai 1909, à 20h30, sous l’égide du
Club du Proletari, une conférence consacrée au « parti ouvrier et
la religion ». Le dimanche 2 janvier 1910, il écrivait à sa sœur :
« aujourd’hui même, je compte aller dans un cabaret pour une goguette
révolutionnaire avec des chansonniers » (en français dans le
texte), reprenant ainsi les termes mêmes d’un programme de la Muse Rouge,
ce qui a fait penser à Robert Brécy que c’est elle qu’il allait voir, et ici.
La salle Jules étant devenue trop petite, la Muse Rouge se produisait en effet
rue de Bretagne depuis 1910, si son siège était resté boulevard Magenta.
André Breton, alors correcteur d’épreuves à la NRF, puis conseiller
artistique du couturier Jacques Doucet, aux appointements de 800 francs par
mois, nouveau « salarié » donc (il vient d’abandonner médecine à
l’hôtel des Grands Hommes), s’en va, en compagnie d’Aragon, adhérer au Parti
socialiste, comme l’on dit encore dans l’immédiat après-congrès de Tours :
« Voilà, nous sommes à votre disposition, nous ne sommes pas des
communistes, mais nous ferons ce que nous pourrons pour le devenir... »
Mis en vers ensuite par Aragon dans les
Yeux et la mémoire, ça aura beaucoup d’allure : « Il m’eût
fallu une âme bien mesquine / Pour ne pas me sentir cet hiver-là saisi / Quant
au Congrès de Tours parut Clara Zetkin / D’un frisson que je crus être la
poésie (...) Cet après-midi-là je fus rue de Bretagne (...) Le ciel gris de
Paris au sortir du local / J’errais Il y avait par là dans ce quartier / Le
siège de la Première Internationale / On vient de loin disait Paul
Vaillant-Couturier ». Sauf que ce jour de janvier 1921, d’y voir un « gros
homme » nommé Georges Pioch, et son « espèce de fausse
bonhomie » suffit à leur faire faire demi-tour.
 |
| Le restaurant de la Maison commune à midi |
Quelque temps plus tard, c’est Hô Chi Minh qui vient profiter ici des
goguettes de chaque premier dimanche des mois d’octobre à mai, où il retrouve
ses amis Voltaire et Renan, vrais prénoms d’état civil des fils du gérant des
lieux.
La Fédération Nationale des Cercles de Coopératives Révolutionnaires,
qui s’est constituée en avril 1925 pour « le redressement et
l’assainissement de la Coopération française au moyen de la Coopération
révolutionnaire, lutte de classes, par opposition avec le Coopératisme dit de
neutralité politique, imposé aux Coopératives de consommation » comme
l’écrit Georges Marrane dans sa
brochure, a fait triompher la ligne du parti au 49 rue de Bretagne. Quand, le
26 mars, l’Humanité publie une « Mise en garde contre le groupe la
Muse Rouge », la Muse Rouge n’a plus qu’à quitter les lieux.
En face, au 46: Mairie du 3e arrondissementédifiée sous le
Second-Empire. De style néo-Renaissance, la façade s'inspire des châteaux des
XVIe et XVIIe siècles français et italiens. La partie la
plus spectaculaire est l'escalier d'honneur se développant dans le hall
d'entrée.
Ayant accédé au péristyle, le
visiteur découvre un plafond concave décoré de bas-reliefs de Jean Lagrange.
Dans les angles, les symboles des arts et des métiers; dans les caissons
octogonaux, les différentes étapes de la vie du citoyen, et c'est pour les
anars que l'on fait le détour : après La Naissance et Le Mariage, Le Vote y
précède La Mort. Ils furent achevés en 1866.
- 90, rue des Archives, MH : Vestiges de l'ancienne chapelle
Saint-Julien-des-Enfants-Rouges, de 1533.
 |
| 78, rue des Archives. Atget. Gallica |
- 78,
rue des Archives (et 12 rue Pastourelle), MH : Ancien hôtel Amelot de Chaillou,
ou hôtel de Tallard du 18ème siècle, de Pierre Bullet.
- 76,
rue des Archives (et 19-21 rue Pastourelle), MH : Hôtel Le Pelletier de Souzy,
de 1642.
 |
| 70, rue des Archives. Atget. Gallica |
- 70,
rue des Archives, MH : Hôtel de Michel Simon ou de Montescot, de 1728.
- rédaction de la Scène
Ouvrière, 68, rue des Archives,
durant l’année 1931. L'ex hôtel Pomponne de Refuge, puis de
Vougny à compter de 1728, fut le premier siège de la Fédération du Théâtre Ouvrier de France
(permanence tous les samedis de 14 à 17h), dont le congrès constitutif avait eu
lieu le 25 janvier 1931.
La création de la FTOF a mis à
l’ordre du jour la transformation des troupes de théâtre amateur en groupes
d’agit-prop, et instauré le sectarisme : le numéro 3 de la Scène Ouvrière, en mars 1931,
lance à son tour l’anathème sur La Muse Rouge. Mais la revue a surtout pour
rôle de fournir un répertoire : son numéro suivant propose une saynète,
« A bas le sport bourgeois », qui a pour épilogue :
« Travailleurs, le sport bourgeois est pourri, le sport bourgeois c’est le
militarisme. Adhérez à votre organisation sportive de classe, à la FST. Formez
des comités de spartakiade pour envoyer des délégués à Berlin en
juillet. » On y trouve encore un
appel « Aux métallos ! », chœur parlé pour 12 à 20 personnes
s’adressant à ceux de chez Citroën, Renault et Peugeot, qui scanderont
« Vive le front unique des travailleurs ! A bas les chefs traîtres
réformistes ! A bas la guerre contre l’URSS ! Vive l’unité syndicale
de classe CGTU ! » Dedans, un portrait de M. Citroën, « qui perd
12 millions par nuit », deux ans avant les « actualités » que Prévert fournira sur le même thème.
Enfin un autre chœur parlé, pour une douzaine de participants, proteste contre
l’enlèvement du militant communiste N’Guyen
van Tao par la police de Chiappe.
- en tournant rue Pastourelle, on
marche entre les flancs de l'hôtel Amelot de
Chaillou, ou de Tallard à gauche, et l'hôtel Le Pelletier de Souzy à droite,
puis:
- 6, rue Pastourelle, MH : Immeuble dit hôtel Beautru de la Vieuville ou Bertin de
Blagny, du 18ème siècle.
- 29,
rue de Poitou (et 15, rue de Saintonge), MH : boulangerie de 1900. Le décor est
d'une grande qualité ; il provient du célèbre atelier de décoration Benoist et
Fils spécialisé dans le décor des magasins d'alimentation (1885-1936) ;
l'installateur est Ripoche. La façade de la boutique se compose d'un coffrage
de bois très simple, mouluré et décoré par quatre toiles peintes fixées sous
verre : une inscription, un paysage (moulin), une semeuse et un moissonneur
(ce panneau a été refait). L'intérieur est entièrement décoré dans ses parties
hautes de toiles peintes fixées sous verre. Le plafond se compose d'un grand
ciel délimité par un feston ; il rappelle un plafond de Watteau. Ce thème est
très fréquent dans l'atelier Benoist ; aux angles, les quatre saisons sont
représentées par des paysages... Deux autres fixés représentent la moisson et
les semailles. Les corniches sont ornées de guirlandes de fleurs : anémones -
roses - lilas. L'ensemble de ce décor est très caractéristique de l'atelier de
Benoist. Le mobilier ancien subsiste : une caisse et deux dessertes de marbre.
- domicile de Karl Marx, 10 rue Neuve-de-Ménilmontant (auj.
Commines). Marx y arrive en mars 1848 et y restera un gros mois ; il
apporte avec lui le Manifeste communiste,
qu’Ewerbeck veut se charger de faire traduire, à Paris, en italien ("Uno
spettro s'aggira per l'Europa - lo spettro del comunismo.") et en espagnol
("Un espectro se cierne sobre Europa: el espectro del comunismo."),
et il attend des fonds pour ce faire.
Les bâtiments contemporains de
Marx:
- 14 rue Commines, PLU :
Remarquable immeuble Louis-Philippe. Façade ornée au premier étage d'une
serlienne à colonnes corinthiennes que surmonte un fronton. Garde-corps en
fonte à motifs de palmette. La porte cochère avec ses vantaux en bois sculptés
et une belle imposte en fonte, est encadrée de pilastres doriques laurés. Le
passage-vestibule, voûté d'arêtes, a conservé une torchère dans une niche.
L'aile de droite renferme un grand escalier dont les barreaux sont parfaits en
leurs extrémités d'un motif végétal qui s'enroule sous la main courante.
Remarquable revers de la façade sur rue avec un balcon au premier au-dessus de
l'entresol. La cour, aujourd'hui parasitée, se terminait par un mur en
hémicycle avec une fontaine.
-16 rue Commines, PLU : Immeuble
de la première moitié du XIXe siècle
présentant une façade en avant-corps bornée de refends composée de quatre
travées et de trois étages carrés sur rez-de-chaussée. Le rezde-chaussée simule
un faux appareil de pierre. Décor de pilastres au troisième étage. Dais sur consoles
au-dessus des fenêtres du premier étage. Chambranles moulurés. Persiennes.
Porte piétonne et fenêtre du rez-de-chaussée en plein cintre. Corniche à
modillons à la retombée du toit.
- 19 rue Commines, PLU : Immeuble
de rapport Louis-Philippe construit par l'architecte Villemsens en 1847 et présentant
une façade en pierre de taille composée de cinq travées et de quatre étages
carrés sur rez-de-chaussée. Elle est percée de baies aux embrasures biaises peu
courantes.
- le café Schiever, passage Saint-Pierre-Amelot. Un lieu
de réunion de la Ligue des justes,
le café Schiever, était juste de l’autre côté du boulevard des
Filles-du-Calvaire, passage Saint-Pierre-Amelot dans le 11e
arrondissement.
- bistrot et goguette, rue de
la Folie-Méricourt, face à la cité Popincourt. A la fin de 1933, Lazare
Fuchsman, l’un des membres du groupe
Octobre, y vit arriver Jacques
Prévert vêtu d’une soutane, et se mettre à tenter de ramener à Dieu tous
les enragés communistes présents. Après quoi, naturellement, tout finit par des
chansons.